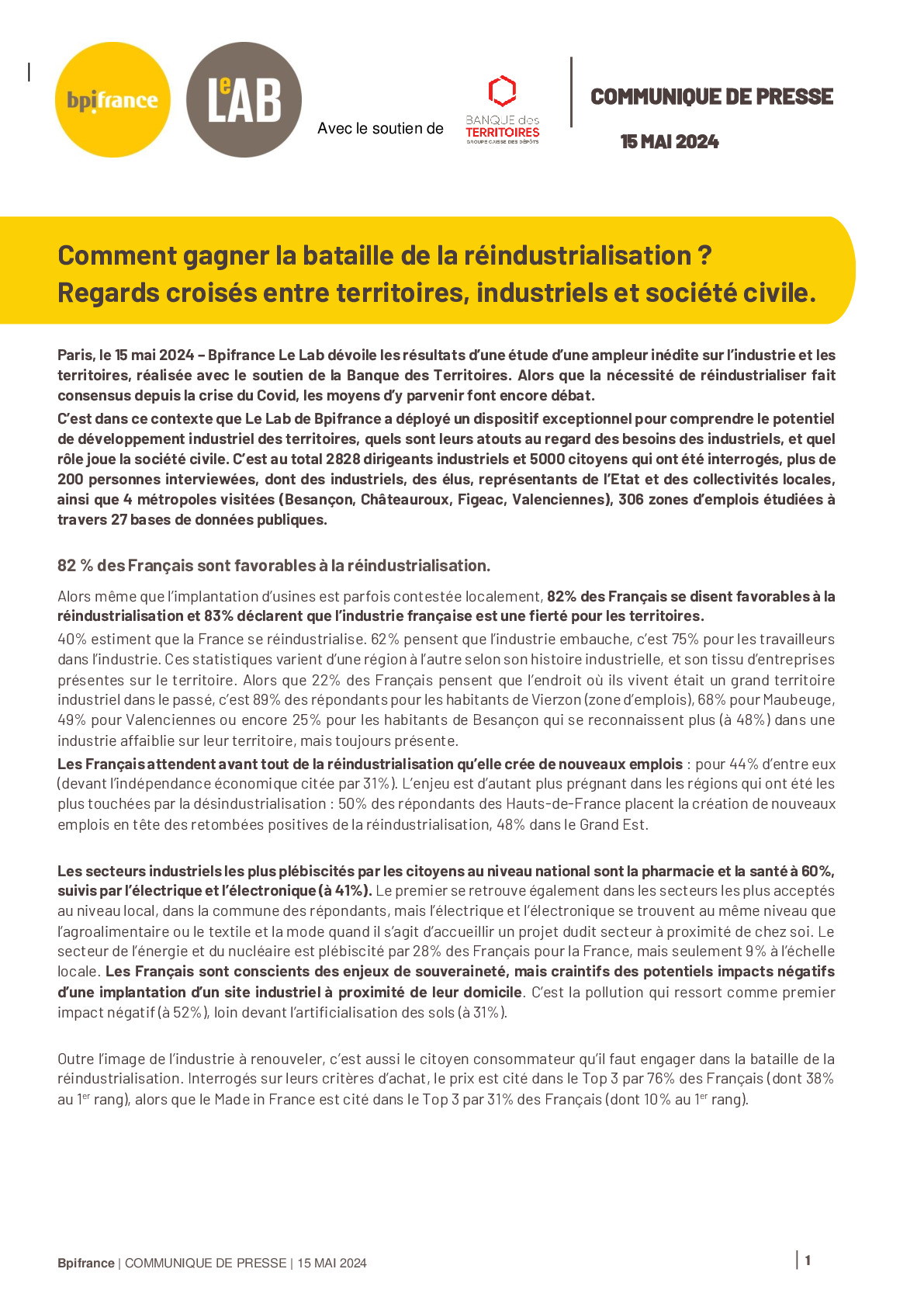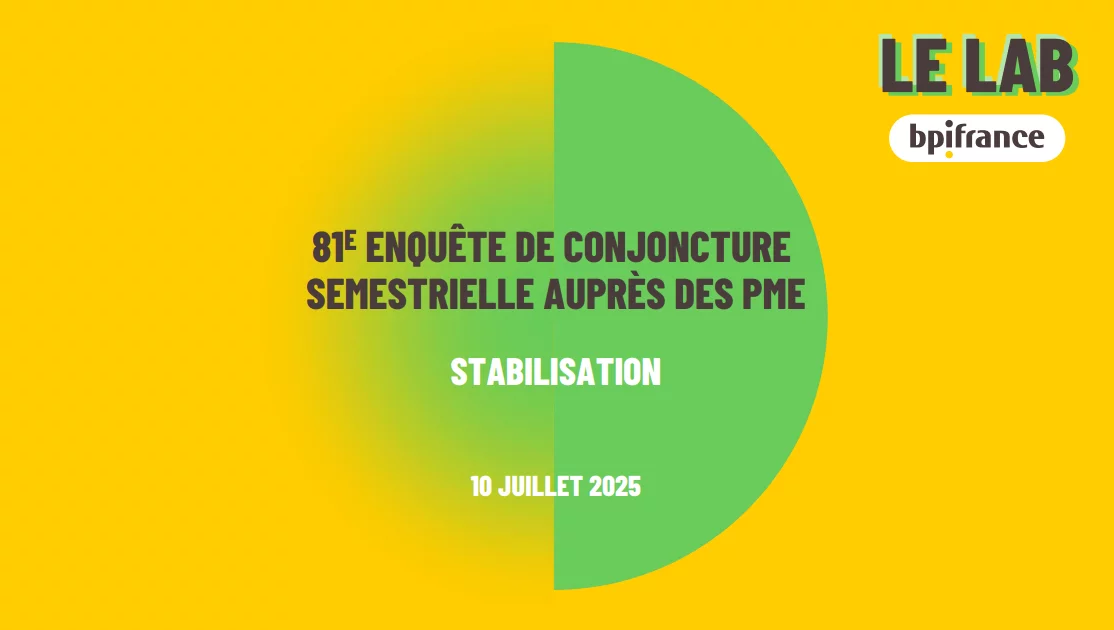Paris, le 15 mai 2024 – Bpifrance Le Lab dévoile les résultats d’une étude d’une ampleur inédite sur l’industrie et les territoires, réalisée avec le soutien de la Banque des Territoires. Alors que la nécessité de réindustrialiser fait consensus depuis la crise du Covid, les moyens d’y parvenir font encore débat.
C’est dans ce contexte que Le Lab de Bpifrance a déployé un dispositif exceptionnel pour comprendre le potentiel de développement industriel des territoires, quels sont leurs atouts au regard des besoins des industriels, et quel rôle joue la société civile. C’est au total 2828 dirigeants industriels et 5000 citoyens qui ont été interrogés, plus de 200 personnes interviewées, dont des industriels, des élus, représentants de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que 4 métropoles visitées (Besançon, Châteauroux, Figeac, Valenciennes), 306 zones d’emplois étudiées à travers 27 bases de données publiques.
82 % des Français sont favorables à la réindustrialisation.
Alors même que l’implantation d’usines est parfois contestée localement, 82% des Français se disent favorables à la réindustrialisation et 83% déclarent que l’industrie française est une fierté pour les territoires.
40% estiment que la France se réindustrialise. 62% pensent que l’industrie embauche, c’est 75% pour les travailleurs dans l’industrie. Ces statistiques varient d’une région à l’autre selon son histoire industrielle, et son tissu d’entreprises présentes sur le territoire. Alors que 22% des Français pensent que l’endroit où ils vivent était un grand territoire industriel dans le passé, c’est 89% des répondants pour les habitants de Vierzon (zone d’emplois), 68% pour Maubeuge, 49% pour Valenciennes ou encore 25% pour les habitants de Besançon qui se reconnaissent plus (à 48%) dans une industrie affaiblie sur leur territoire, mais toujours présente.
Les Français attendent avant tout de la réindustrialisation qu’elle crée de nouveaux emplois : pour 44% d’entre eux (devant l’indépendance économique citée par 31%). L’enjeu est d’autant plus prégnant dans les régions qui ont été les plus touchées par la désindustrialisation : 50% des répondants des Hauts-de-France placent la création de nouveaux emplois en tête des retombées positives de la réindustrialisation, 48% dans le Grand Est.
Les secteurs industriels les plus plébiscités par les citoyens au niveau national sont la pharmacie et la santé à 60%, suivis par l’électrique et l’électronique (à 41%). Le premier se retrouve également dans les secteurs les plus acceptés au niveau local, dans la commune des répondants, mais l’électrique et l’électronique se trouvent au même niveau que l’agroalimentaire ou le textile et la mode quand il s’agit d’accueillir un projet dudit secteur à proximité de chez soi. Le secteur de l’énergie et du nucléaire est plébiscité par 28% des Français pour la France, mais seulement 9% à l’échelle locale. Les Français sont conscients des enjeux de souveraineté, mais craintifs des potentiels impacts négatifs d’une implantation d’un site industriel à proximité de leur domicile. C’est la pollution qui ressort comme premier impact négatif (à 52%), loin devant l’artificialisation des sols (à 31%).
Outre l’image de l’industrie à renouveler, c’est aussi le citoyen consommateur qu’il faut engager dans la bataille de la réindustrialisation. Interrogés sur leurs critères d’achat, le prix est cité dans le Top 3 par 76% des Français (dont 38% au 1er rang), alors que le Made in France est cité dans le Top 3 par 31% des Français (dont 10% au 1er rang).
6 industriels sur 10 ont un projet d’implantation en France, soit 1703 projets sur les 2828 répondants : 38% signalent une intention d’extension de leur site existant, 14% la création d’une nouvelle installation, 8% un déménagement, et 3% une relocalisation d’activités.
Ces projets sont le reflet des ambitions de croissance des industriels qui prévoient d’accroître en moyenne leur chiffre d’affaires de 4% par an dans les trois prochaines années.
Derrière les intentions des industriels, se dessine une dynamique de grande proximité. 43% des dirigeants déclarent vouloir s’implanter à proximité directe de leur usine et 22% dans leur commune ou la commune voisine, preuve de leur rapport affectif au territoire. 86% déclarent y être personnellement attachés, parce qu’ils y ont grandi ou fait leurs études.
Preuve également de l’importance des compétences pour un chef d’entreprise industrielle qui veut fidéliser ses salariés, et surtout éviter de les perdre avec un déménagement trop lointain de leur domicile. La pénurie de compétences est le premier frein local (frein très fort et plutôt fort pour 82% des répondants), devant la raréfaction du foncier (57% des répondants) et le manque d’infrastructures adaptées (35%). La faible qualité du dialogue avec les élus est citée comme un frein (très fort ou plutôt fort) par 25% des répondants, de même que l’acceptabilité sociale.
A rebours des idées reçues, les besoins des industriels se concentrent sur du « petit foncier » aligné avec leurs projets d’extension. 69% des répondants ayant un projet de nouvelle implantation ont besoin de moins de 2 Ha. Parmi eux, les ETI sont les entreprises ayant les besoins en foncier les plus importants : 15% des ETI ont des besoins de 5 à 10 Ha (contre 8% dans la moyenne de l’échantillon), et 14% ont des besoins supérieurs à 10 Ha (contre 4% dans la moyenne de l’échantillon).
La taille des entreprises détermine le rapport au territoire de leurs dirigeants, leur stratégie de croissance et leurs critères d’implantation.
Interrogés sur les critères d’implantation qu’ils jugent déterminants pour leur prochain site, les dirigeants d’entreprises industrielles anticipant une croissance annuelle supérieure à 5% décrivent des préférences différenciées selon la taille de l’entreprise qu’ils dirigent (start-up, PME, ETI). Leur attachement au territoire et leurs besoins diffèrent, ce qui permet d’identifier des territoires de prédilection distincts pour chaque catégorie d’entreprises :
- Les PME privilégient le petit foncier et l’expansion de proximité. Ainsi, cartographier leurs préférences revient à mettre en exergue les territoires pourvus d’un écosystème de PME industrielles.
- Les ETI ont besoin de foncier plus important (de 5 à 10 hectares) et de main d’œuvre. Elles sont également plus sensibles à la présence de ressources en eau et aux risques environnementaux. Ainsi, les territoires pourvus en foncier et en talents sont particulièrement prisés.
- Enfin, les start-ups industrielles déclarent trois priorités : les infrastructures, les centres de recherche et la qualité de vie du territoire. Ainsi elles seront particulièrement attirées par les métropoles ; bien reliées, elles offrent une proximité directe aux centres de recherche et à tous les autres services.
Le rapport au territoire des industriels est révélateur de leur stratégie d’implantation : les PME y sont très attachées et désirent y rester, les ETI le sont un peu moins et cherchent des territoires répondant à leurs besoins à mesure qu’elles grandissent en taille, les start-up industrielles – souvent implantées là où les dirigeants ont fait leurs études – ont une approche rationnelle du territoire dès les premiers stades de leur développement, guidés par la proximité avec les centres de recherche (instituts de recherche technologique…).
Les territoires ont de multiples atouts à faire valoir auprès des industriels.
Plusieurs cartes réalisées à partir de données publiques illustrent ces atouts, parmi lesquels le foncier et les infrastructures, rassemblés sous le terme de « capital physique » et valorisant les territoires très industrialisés par le passé (et ayant connu une forte désindustrialisation), la culture industrielle lisible à travers le tissu d’entreprises industrielles (nombre d’entreprises, nombre et taux d’emplois industriels, binôme Territoires d’industrie, etc.), les compétences avec les écoles de niveau Bac+3 formant aux métiers industriels, la qualité de vie (accès aux écoles, aux soins, etc.) valorisant les métropoles, et enfin la moindre exposition aux risques environnementaux.
L’étude propose une synthèse de ces atouts en pondérant chacun selon l’appréciation des 2828 industriels ayant répondu à l’enquête. En ressort une carte de France qui questionne le potentiel à venir, versus la dynamique récente de l’emploi manufacturier.
Chaque territoire offre un terrain de jeu différent aux industriels. Ainsi, quatre profils de territoires émergent :
- Les locomotives historiques sont des territoires qui ont su réinventer leur outil industriel sans subir la désindustrialisation, grâce à une forte culture industrielle et l’impulsion de grands donneurs d’ordre. Par exemple : la Vallée de la Chimie en Rhône-Alpes, Lyon, Nantes ou Toulouse.
- Les indépendants agiles représentent des territoires industriels ruraux, dotées d’une industrie autocentrée souvent liée à l’agriculture, caractérisées par une coopération solide et une spécialisation dans un nombre restreint de filières. Par exemple : Figeac, la Roche sur Yon, Ancenis.
- Les rebonds sont des territoires ayant surmonté la désindustrialisation pour connaître une renaissance industrielle, tirant parti de leurs friches, de leur héritage manufacturier et de leur position géographique stratégique. Par exemple : les Hauts de France et le Grand Est.
- Enfin, les néo-industriels désignent des territoires sans tradition industrielle mais qui connaissent une dynamique industrielle récente, appuyée par un écosystème d’innovation solide, des centres de formation et de recherche, et une base solide de cadres et d’ingénieurs. Par exemple : Montpellier.
Le tissu industriel existant représenterait 70% de la marche à franchir pour atteindre la cible de réindustrialisation d’une balance commerciale manufacturière équilibrée.
Réindustrialiser pour atteindre une part de l’industrie manufacturière dans le PIB à 12 % à horizon 2035, c’est gagner 233 Md€ de valeur ajoutée manufacturière supplémentaire d’ici 2035. Les entreprises industrielles actuelles y contribueraient à environ 162 Md€ de Valeur Ajoutée d’ici 2035, correspondant à la croissance de leur activité, issue pour la majorité d’entre elles, de la diversification de l’offre produits et de la hausse des volumes vendus, loin devant la montée en gamme et le développement à l’international. Le tissu industriel existant représenterait ainsi deux tiers de la marche à franchir, le dernier tiers devant être réalisé par de nouveaux projets, français ou étrangers.
Et derrière ces pourcentages, un choc d’emplois est à anticiper, puisque selon nos hypothèses de croissance et de gains de productivité, la cible de réindustrialisation indiquée impliquerait entre 600 000 et 800 000 emplois nets créés à horizon 2035, soit entre 50 000 et 67 000 emplois salariés supplémentaires par an entre 2023 et 2035 (contre +32 000 en moyenne par an entre 2021 et 2023). Les compétences sont au cœur de la bataille de la réindustrialisation, dans la mesure où l’industrie compte déjà chaque année 60 000 postes non pourvus (source : DARES), et que si l’appareil de formation forme bien 120 000 jeunes par an, la moitié seulement reste dans l’industrie (source : Fabrique de l’industrie).
Méthodologie de l’étude :
- Un cadrage macroéconomique
- Un travail en chambre, challengé par le Copil et des industriels, pour mesurer – à partir d’une trentaine d’indicateurs – le potentiel de développement industriel des territoires et sa cartographie par zones d’emploi françaises
- Plus de 200 personnes interviewées :
- Dans le cadre de rencontres dans 4 territoires choisis pour leurs caractéristiques industrielles, rassemblant représentants de l’Etat, des Régions, des EPCI, et des industriels : Figeac le 23 février 2024, Valenciennes le 18 mars, Châteauroux le 27 mars et Besançon le 5 avril. Pour ces rencontres, nous avons été accompagnés par les cabinets Ernst&Young, et Compagnum.
- Dans le cadre d’entretiens réalisés auprès de dirigeants industriels, d’acteurs locaux et d’élus, de chercheurs, d’acteurs de la formation et d’experts de l’industrie.
- Une enquête menée du 15 janvier au 22 mars 2024 auprès de 2828 dirigeants d’entreprises industrielles. Nous avons interrogé les 30 000 unités légales (en excluant les entreprises ayant moins de 10 salariés), ce sont donc les directeurs de site qui nous ont répondu. Dans ces 2828 répondants :
- 8% de start-up industrielles,
- 57% de PME ayant moins de 10 millions d’euros de CA,
- 23% de PME ayant entre 10 et 50 millions d’euros de CA
- 10% d’ETI
- 0,7% de grandes entreprises (soit 20 des 81 grandes entreprises du secteur de l’industrie manufacturière en France).
- Une enquête menée du 14 décembre 2023 au 13 février 2024 auprès d’un échantillon de 5000 citoyens français, représentatif selon le genre, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle et la région. Il est complété par des sur-échantillons sur 49 zones d’emploi spécifiques sur les 306 au total en France métropolitaine (à proximité de sites SEVESO par exemple), représentant 4400 répondants supplémentaires. Cette enquête a été réalisée par Potloc.
Retrouvez l’intégralité de l’étude en annexe ci-dessous et également sur : lelab.bpifrance.fr